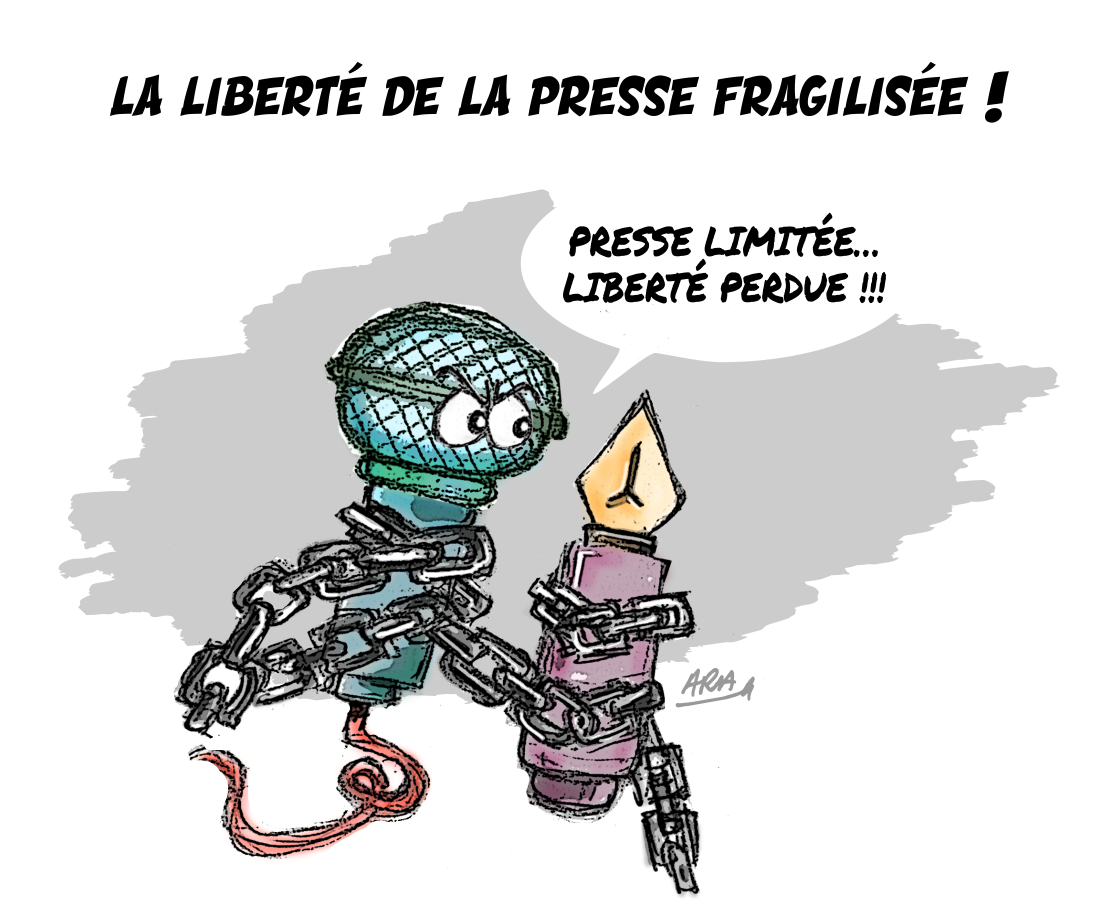2001, l'Odyssée de l'espace (1968) de Stanley Kubrick

CRITIQUE - Si L'Odyssée d'Homère est le premier « roman » marquant le désir de partir à la découverte du monde, 2001, l'Odyssée de l'espace est la première œuvre de fiction moderne avec son ordinateur cyclopéen à proposer l'étape suivante de cette exploration du monde. Il tente de brasser l'aventure humaine et sa complexité. Il clôt et, en même temps, prolonge le récit homérique, l'exploration non plus des contrées de la mer du couchant, mais les territoires silencieux, infinis et effrayants de l'espace : nouvelle étape et nouveau saut dans l'exploration et la connaissance du monde annonçant du même coup la fin de la première phase terrestre de l'Histoire humaine.
Rentrons donc dans ce chef-d'œuvre d'une rare ampleur, obscur et fascinant, limpide et dense. Le préambule débute par une image de la Terre, de la Lune et du Soleil qui vont être rigoureusement alignés. La musique de Richard Strauss Ainsi parlait Zarathoustra retentit : son thème est souligné par une ligne ascendante de trois notes do-sol-do qui se relient aux trois sphères que nous voyons sur l'écran : la Lune, le Soleil et la Terre. Ce poème symphonique, qui emprunte son titre à l'œuvre du philosophe Nietzsche, donne toute l'ampleur du film.
Découpé en quatre parties, la première intitulée L'Aube de l'humanité nous plonge au début de l'espèce humaine. L'homme à l'état de nature, pulsionnel, violent. Moment crucial où notre ancêtre va acquérir une conscience et devenir autre chose qu'un animal : un homme. Des paysages désertiques, arides, brûlés par le soleil. En ces temps reculés, les singes se sont regroupés en bande et vivent de cueillettes. Le danger est permanent tel ce léopard qui attaque l'un des singes. Kubrick met le doigt sur ce qui fonde le comportement premier de l'individu. Il montre deux bandes de singes rivalisant d'agressivité pour conquérir un point d'eau. Le groupe qui en avait jusqu'à présent la jouissance est obligé de reculer sous la menace et l'affrontement. Ici, il n'y a point de raison encore pour légitimer un quelconque territoire comme cela arrivera par la suite.
Cette base indique que l'individu doit transcender cette irrationalité fondatrice, déguisée par la suite derrière des alibis logiques ou culturels. Ce n'est qu'à ce prix qu'il pourra accéder à ce qui le fonde en tant que tel. Rien ne dit que la chose soit possible, à une échelle personnelle ou à une échelle collective. Le comportement humain recèle toujours des motivations cachées dérivées de ce comportement premier. C'est aussi dire que l'être humain n'est pas transparent à lui-même et que pour se saisir, il faut qu'il en passe par un apprentissage, par autrui. Dans un article, Kubrick cite l'anthropologue Robert Ardrey.
Un beau matin, apparaît un monolithe noir, lisse à la géométrie parfaite. C'est l'affolement. La fascination. Peu à peu, les singes s'en approchent et finissent par le toucher, par l'adorer tel un Dieu, et Stanley Kubrick utilise la musique envoûtante de György Ligeti pour créer ce climat irrationnel, d'attirance et de peur que suscite l'apparition de ce troublant artefact.
Kubrick est parti d'une nouvelle d'Arthur C. Clarke pour écrire en collaboration par la suite avec lui le scénario de 2001, l'Odyssée de l'espace. Ce monolithe surgit comme une chose incongrue et parfaite dans ce monde hostile. Si les extraterrestres sont relégués dans un perpétuel hors champ au point, ce qui préoccupe le cinéaste est l'influence qu'exerce ce monolithe : l'apparition d'un embryon de « réflexivité » chez l'un des singes, et qui aboutira à la maîtrise et à la conquête de territoire.
Peu après, ce singe comprend qu'un simple os permet de tuer plus facilement pour se nourrir. L'os change de nature, il devient une arme. Non seulement Kubrick souligne que cette découverte est cruciale et fondatrice en découpant sa séquence sur le plan cinématographique, mais il insiste sur cette découverte qui s'opère dans une extase destructrice, décuplant ses fonctions primitives. Ainsi parlait de Zarathoustra de Richard Strauss est réintroduit. Jusque-là, les plans fixes établissaient un environnement stable, pris comme de l'extérieur, objectif. À cet instant, un plan précis montre la verticalité du monolithe dans une contre-plongée vertigineuse. Le monde était horizontal ; il devient vertical. L'homme acquiert une volonté transcendantale, liée au monolithe, au jet vertical de l'os dans le ciel, à Hal et à l'enfant à la toute fin. L'homme est en marche après s'être mis debout.
Dès lors, le singe, l'os à la main, tue un animal et nourrit tout le groupe. Cet acquis a un impact : les autres singes imitent le premier. La transmission de ce savoir est assurée. La bande de singes reconquiert le point d'eau, reconquête qui s'effectue par un meurtre. Ivre d'extase là encore, le singe jette l'os en l'air. La caméra suit l'os qui monte dans le ciel et redescend. Il devient un vaisseau spatial dans l'un des plus somptueux raccords du cinéma. Nous avons fait un saut. Trois millions d'années viennent de s'écouler en un instant. Le raccourci est saisissant, audacieux, typiquement visuel, totalement cinématographique.
Kubrick établit le paradoxe que plus la connaissance progresse, l'homme découvrant et maîtrisant son environnement, plus celle-ci est liée à l'anéantissement d'autrui. Cet instrument de connaissance est donc aussi un instrument de mort dans le sens où cette connaissance de l'outil a servi à dominer et à imposer une logique destructrice. Constante dans le cinéma de Kubrick où la pulsion de mort est liée à la rationalité. L'homme est devenu un être civilisé. Le mécanisme de base qui a engendré l'utilisation de l'os est cependant le même.
La deuxième partie débute sur la célèbre valse Le Beau Danube bleu de Johann Strauss en symbiose avec le ballet du vaisseau spatial et de la roue. L'espace à maîtriser n'est plus le monde terrestre, mais l'espace intersidéral. Kubrick place cette valse sur des images d'espace, liant harmonieusement les déplacements géométriques du vaisseau et de la grande roue. Il retraduit la beauté glacée de cette technologie tout en nous faisant sentir son côté morbide. Car n'oublions pas, tout part de l'os, la liaison entre la pensée et le meurtre. L'invention et la mort. La rationalité et l'irrationalité.
La roue spatiale fait penser à celle du Prater de Vienne, référence non forcée étant donné que le compositeur viennois est convoqué pour ce majestueux ballet. Comme cette Vienne de la fin du XIXe siècle qui est d'une haute culture (la musique de Gustav Mahler, les romans d'Arthur Schnitzler dont Kubrick adaptera La Nouvelle rêvée pour Eyes Wide Shut, mais aussi Freud), culture qui ne pourra empêcher la Première Guerre mondiale. Car pour le cinéaste, la Culture est indissolublement liée à l'irrationalité. Le plus subtil est que toutes ces figures esthétiques, cette orchestration cinématographique d'un grand raffinement, laissent place à un tombeau : c'est ce que suggère le monolithe. Ce dernier est un tombeau.
Kubrick s'est intéressé au XVIIIe siècle, à l'Empire austro-hongrois, à la Culture allemande, bref, aux coulisses de l'irrationnel qui ont régi les guerres, les révolutions, les apocalypses. Impuissance de la Culture à empêcher l'apparition de la destruction. Dualité intrinsèque à la nature même de l'homme, animal doué de raison et de passions, bâtisseur et destructeur en même temps. Cette dualité et ce paradoxe sont inscrits dans les sujets et dans la mise en scène même du cinéaste qui construit son quadrillage de l'espace cinématographique en figures géométriques (travellings avants-arrières-latéraux) souvent contrariées par une caméra tenue à la main qui suggère l'irruption de l'irrationnel dans l'imaginaire des personnages. Cette irrationalité est décuplée par la rationalité humaine. Elle prend place non d'une façon purement bestiale, mais est comme stylisée, esthétisée si l'on veut. Elle ne peut naître qu'avec la raison. Le développement de cette dernière permet à l'homme de maîtriser son environnement, de coloniser d'autres peuples tout en développant une culture hautement raffinée. Ce qui contredit l'idée banale que la Culture serait un rempart contre la barbarie. D'ailleurs, la Culture n'a jamais été là pour enrayer la barbarie, mais pour la comprendre tout du moins. Et la retranscrire sans la légitimer dans une forme esthétique accomplie.
Nous faisons connaissance avec le docteur Heywood Floyd (William Sylvester) alors que celui-ci se rend sur la Lune, là où un signal étrange provenant d'un monolithe noir est émis en direction de Jupiter. Séquence connue avec moult effets spéciaux. La séquence avec la petite fille du docteur est révélatrice de ce qu'est devenu notre monde actuel, fait d'écrans et de communications à distance. Cette séquence fait peu avancer l'action. L'intrigue est révélée au compte-goutte, notamment lorsque les Russes tentent de faire parler Heywood Floyd. Quête de territoire, non plus entre des singes, mais entre des singes savants, les Américains et les Soviétiques de l'époque. Rien n'a donc changé, sauf que la diplomatie règne en maître. Rapports aseptisés, univers feutré cachant la prédation derrière la communication. De nos jours, cette représentation s'est renforcée, installant un monde du Bien, poli comme l'indique la publicité à un niveau jamais atteint. Kubrick met en perspective ce mode de vie largement virtualisé (la nourriture synthétique), c'est-à-dire des hommes coupés de leur être, un mode de vie scindé de la nature et du cosmos. Et pourtant, nous sommes en plein espace !
Le but secret de cette mission derrière la communication est le monolithe. Nous le revoyons dans l'un des cratères lunaires, déclenchant un signal sonore perturbant la prise de la photo de groupe. Ironie kubrickienne que de signaler la fausseté de la représentation imagée derrière cette fierté humaine par un signal sonore ! Nous sommes toujours trahis par un élément perturbateur, un défaut qui fait dérailler notre volonté de perfection.
La troisième partie, intitulée Mission Jupiter, dix-huit mois plus tard, a un tempo plus lent. C'est aussi la plus dramatique au niveau émotionnel. Long défilement du vaisseau spatial en route vers Jupiter sur la musique d'Aram Khatchaturian évoquant à merveille l'ennui et la mélancolie. Entraînement des deux cosmonautes, Dave Bowman (Keir Dullea) et Frank Poole (Gary Lockwood). L'un fait du footing et joue aux échecs, jeu préféré de Kubrick. Ce sont des hommes sans ombre, à l'instar du roman de Chamisso, La Merveilleuse histoire de Peter Schlemilhl, ou l'homme qui a perdu son ombre. Kubrick s'est attaché le plus possible, au niveau de la lumière, à effacer les ombres de ses personnages pour traduire cette idée. Ennui métaphysique, humains vidés de leur substance. La scène la plus caractéristique est celle où Frank, se faisant bronzer, reçoit une vidéo de ses parents lui souhaitant un bon anniversaire. Elle joue du contraste entre les parents joyeux et Frank écoutant froidement, à distance. Solitude de l'homme absent à lui-même.
L'important n'est pas tant que la machine imite l'homme, mais que l'homme imite la machine. Lors d'un reportage télévisé, Frank Poole dit à propos de Hal : « C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il est le sixième membre de l'équipage. On s'habitue très vite au fait qu'il parle, et on finit par penser à lui comme... comme à un être humain. » Se pose la question de l'humanité de Hal, étant donné que les hommes l'ont désertée. Kubrick reprend son idée maîtresse de la simulation, du masque, de la confusion entre l'homme et la machine, l'humain et l'artefact, ce moment troublant où le réel et l'irréel sont inextricablement liés.
À un moment donné, Hal bat Frank aux échecs. Signe que la technique ne bat pas seulement l'homme, elle le domine et inverse les polarités. L'homme est devenu le terminal de Hal, ce que nous voyons de nos jours avec les ordinateurs, les téléphones portables, les réseaux sociaux. L'homme est virtualisé, se vit comme un simulacre à lui-même. Nous sommes devenus les réceptacles commerciaux et symboliques de toutes les technologies.
C'est alors que surgit l'incident. Hal détecte que l'élément AE35 va tomber en panne, obligeant Dave à sortir dans l'espace. Or, après examen, l'élément n'est nullement défectueux. Se réfugiant dans un module, Dave et Frank pensent que Hal doit être mis hors fonction. Ils décident de remettre l'ancien élément et d'attendre son éventuelle panne. Sauf que Hal lit sur leurs lèvres. C'est le tournant du film. Hal, entité supra-rationnelle, est celui qui commet l'erreur. C'est par lui que le meurtre revient par la fenêtre après que les hommes ont été dépossédés de leur ombre. C'est au sein de la logique pure que le meurtre humain a lieu.
Qui est Hal alors ? Hal est une métaphore de la nature humaine que l'homme s'est forgé depuis des siècles uniquement basée sur la raison, niant son animalité, ses motivations « pulsionnelles » pour les déguiser en actes logiques. Hal en est le symbole suprême. Il décide pour garder son pouvoir et son territoire d'éliminer les hommes de la mission. Une partie d'échecs symbolique a lieu entre lui et Frank/Dave comme les singes au début avec le point d'eau. C'est devenu plus logique, plus tactique, plus feutré. Cette raison superlative va jusqu'au bout de son programme en créant l'incident elle-même. Ayant expurgé l'ombre, c'est elle qui secrète le mal. La lumière et la transparence, comme on le constate de nos jours, sont devenues l'ombre. Le mal même. Si Hal avait été rationnel, il aurait obéi à sa mission. Hal s'est pris pour Dieu, voyant tout, contrôlant tout. Dieu est mort, l'humain l'a remplacé un temps et, maintenant, c'est Hal. Au point que sa rationalité se transforme en irrationalité. Il tue.
On peut envisager l'ordinateur comme une métaphore de toutes les solutions politiques, idéologiques, économiques et symboliques qui, partant d'une tentative de résoudre le monde, deviennent une idée absolue et folle, éradiquant toute opposition et toute dialectique. Kubrick montre que, derrière toute cette raison, la violence prédomine. Le paradoxe qu'il explore est : plus l'homme se targue de la raison, plus il est manipulé par l'irrationnel. L'homme avance toujours masqué, trouve toujours des raisons pour tuer, déguise souvent ses motivations meurtrières sous des motifs en apparence rassurants, pour le bien de tous, bref, culturels. Il n'est plus ouvertement instinctif et dissimule son animalité derrière un masque de bienséance et de convenances.
L'un des plans les plus bouleversants est celui où Dave voit le corps de Frank s'éloigner dans l'infini de l'espace à travers le hublot de la capsule. Solitude de l'homme dans ce monde si vaste, si écrasant et si froid qui rappelle la phrase de Pascal (« Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie »). Dave va chercher le corps de son ami pour lui offrir une sépulture, mais il est obligé de le relâcher pour revenir dans le vaisseau spatial dont Hal lui interdit l'accès. C'est à ce moment que Dave retrouve sa part d'ombre. On sait que l'humanité devint réellement humaine à partir du moment où elle enterra ses morts. Entretemps, Hal a tué tous les autres occupants en hibernation dans une séquence d'une économie de moyens stupéfiante. Pas de psychologie. Pas d'explication.
Dès lors, Dave revient par le sas de secours et réussit. Ce qui nous vaut l'une des grandes scènes du film, le meurtre de Hal par Dave. Comme si ce dernier reprenait le pouvoir sur la machine par l'intermédiaire de son « animalité ». Meurtre qui lui rend son humanité. La scène est émouvante comme peut l'être une boîte à musique qui égrène une mélodie par l'absence de l'élément humain tout en le simulant. Comme une horloge sans aiguilles qui indiquerait l'heure. Cette dialectique entre raison et irrationalité est liée comme la vie est consubstantiellement ancrée à la mort. Il en va ainsi de l'amour et de la destruction, jusque dans le titre, celui de Docteur Folamour (Docteur Folamour ou comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe). À la fin, un champignon atomique se clôt sur une chanson d'amour ! Dans 2001, en mourant, Hal chante une chanson d'amour : « Daisy, Daisy, donnez-moi votre réponse. Je suis à moitié fou d'amour pour vous. » Si la mise en scène de Kubrick déploie un espace géométrique, il n'opère pas d'une façon conceptuelle, mais poétique, par l'art qui permet de distancier cette pure raison et la dénuder de ses fondements meurtriers.
Dave tue, dans ce meurtre symbolique, la raison surpuissante. C'est à ce titre qu'il redevient homme comme si Kubrick nous disait que l'être humain ne peut renier cette part d'ombre au nom d'une rationalité triomphante. Ce meurtre permet à Dave de mener à bien sa mission et d'aller vers Jupiter. Il apprend par une vidéo, enregistrée par le docteur Floyd avant son départ, que Hal est seul à en avoir eu connaissance. La motivation secrète.
La quatrième et dernière partie, intitulée Jupiter et au-delà de l'infini, nous jette dans l'interrogation la plus totale. Que se passe-t-il ? Où sommes-nous ? Il n'y a plus aucun dialogue, que des images et de la musique, celle du compositeur György Ligeti. Nous assistons à un défilé d'images qui n'est pas sans rappeler l'origine du monde, la naissance de la Terre et de la Vie. Telle la fécondation. Une séquence de huit à neuf minutes. Dave Bowman semble traverser un espace-temps qui lui fait découvrir l'origine même de la vie. Comme un retour en arrière pour en arriver au début du film même. Le big bang pour tout dire.
Kubrick a-t-il voulu nous indiquer que cette vie est d'origine extra-terrestre ? Il est indéniable qu'il se pose la question quant à l'existence d'une forme d'intelligence extrahumaine. Peu importe. Il se sert d'une œuvre de fiction pour poser le problème tout en s'interrogeant sur l'origine de la vie, de l'humanité. Le mystère intégral. Dave Bowman se retrouve dans un décor du XVIIIe siècle. Kubrick conjugue deux décors différents, l'ancien et le moderne, le vaisseau et le décor du XVIIIe siècle, comme il conjuguait l'espace et le Beau Danube bleu. On retrouve le décor aseptisé des toilettes qui hante les films du cinéaste : salle de bain/toilettes dans Eyes Wide shut où Mandy fait une overdose, toilettes où Jack rencontre l'ancien gardien de l'Overlook hotel dans The Shining, toilettes dans Full Metal Jacket quand Baleine se suicide. En général, c'est dans ce décor clinique que la violence surgit. Dave vieillit et se voit vieillir en quelques secondes, vit une vie en quelques instants pour se retrouver dans son lit de mort devant le monolithe noir. Face-à-face terrible de l'homme avec la mort. Le tombeau. Le monolithe.
Dave Bowman meurt, se métamorphose... et renaît sous la forme d'un fœtus. Signe de toute vie. Vie de chair. Mystère au centre de toute la Création. Ressuscite-t-il ? Kubrick conjugue à la fois l'explication religieuse et l'explication scientifique, tout en laissant l'énigme intacte. Il y a aussi un rapport étroit qui unit cette scène avec celle de Jésus-Christ, du moins métaphoriquement, une renaissance aussi liée à Nietzsche et à son Zarathoustra. « Quand vous commencez à vous intéresser à ce genre de sujet, les implications religieuses sont inévitables, parce que tous ces caractères sont ceux que l'on attribue à Dieu. Ainsi voilà donc, si vous le voulez, une définition de Dieu parfaitement scientifique », dit Kubrick dans The film director as a superstar. Le monolithe n'est-il pas la perfection mathématique incarnée et en même temps un tombeau ? Ne montre-t-il pas Dave à la naissance de l'univers et de la vie dont la mort est contenue à l'intérieur ? Il est là au début et à la fin quand Dave meurt.
Bowman renaît. Il fait le parcours inverse (de la mort à la naissance) pour retourner au berceau, la Terre, là où la vie est apparue. Cet enfant revient sur Terre d'une façon « magique », traversant l'espace. Est-il un ange ? Un démon ? Est-il transfiguré en surhomme comme la musique de Richard Strauss Ainsi parlait Zarathoustra (d'après Nietzsche) qui réapparaît, le laisserait supposer ? Le cinéaste n'est pas un théoricien, analysant le monde d'une façon conceptuelle. Il pose question, parce qu'il est difficile d'être dogmatique en ce domaine.
Tant que le film était « concret », il restait logique et cohérent. Mais la séquence finale jette un doute, tant elle est « irréelle ». Ce qui est troublant est que cet enfant est bien froid et mystérieux, enveloppé dans sa matrice bleutée et ronde. Il ne sourit pas et paraît distant. Il nous défie. Cette renaissance n'est-elle pas tant du point de vue religieux que du point de vue politico-économique qu'un renouveau illusoire ? Cet enfant n'est pas optimiste, mais joue de deux idées contradictoires, associant une figure sympathique et un avenir maléfique, bien dans l'optique du cinéaste tout au long de son œuvre. Il s'agit donc d'un plan oxymorique, ironique. Pourquoi Kubrick abandonnerait-il sa critique du monde une fois dans son œuvre, délaissant la cohérence de sa filmographie ? Cette idée optimiste ne met rien en perspective alors que le retour de cette rationalité qui peut anéantir l'espèce humaine est bien plus pertinente, attaquant l'image romantique et béate de l'enfant chargé d'espoir. Il est tout aussi curieux qu'une intelligence extra-terrestre place un monolithe au début du film à destination des hommes, les laissant se massacrer et dominer par la technique pour les sauver à la fin grâce à un enfant chargé de l'humanité enfin assumée. Cela ressemble plutôt à tous les discours religieux et politiques promis aux hommes depuis l'aube de l'humanité et qui ont fini dans un massacre. D'autant qu'on nous fait réécouter la musique de Richard Strauss Ainsi parlait Zarathoustra qui apparaissait au début et quand le singe tue un animal.
Kubrick n'est pas un adepte des révolutions qui, après avoir combattu des oppresseurs avec de belles idées, ont reproduit le même schéma. Il se méfie de tout retour de cet esprit idéaliste qui prétend diriger l'Humanité, mais la plonge au final dans le chaos. Tout simplement parce que derrière la rationalité se cache un processus destructeur qui la mine de l'intérieur, comme le tout premier geste du singe. Enveloppé d'une matrice bleutée et ronde, lumineuse et mortifère, l'enfant évoque la forme circulaire si chère au cinéaste, éternel retour du même, conjugaison de la beauté et de la destruction, une belle chanson d'amour sur fond d'explosions atomiques comme à la fin de Docteur Folamour. Ou comme Jack, l'écrivain fou, qui renaît dans The Shining, lui l'éternel gardien de l'Overlook Hotel.
Notons pour finir que le regard-caméra de l'enfant renvoie au premier plan où Alex nous fixe dans Orange mécanique avec un même regard-caméra. Signifie-t-il que si l'Homme ne fait pas cet effort pour accéder à son être, il ne pourrait devenir qu'un futur Alex, un barbare civilisé ? Tous les films de Kubrick finissent par cette ironie posée comme un défi au spectateur et à toute l'Histoire humaine.
À LIRE AUSSI


L'article vous a plu ? Il a mobilisé notre rédaction qui ne vit que de vos dons.
L'information a un coût, d'autant plus que la concurrence des rédactions subventionnées impose un surcroît de rigueur et de professionnalisme.
Avec votre soutien, France-Soir continuera à proposer ses articles gratuitement car nous pensons que tout le monde doit avoir accès à une information libre et indépendante pour se forger sa propre opinion.
Vous êtes la condition sine qua non à notre existence, soutenez-nous pour que France-Soir demeure le média français qui fait s’exprimer les plus légitimes.
Si vous le pouvez, soutenez-nous mensuellement, à partir de seulement 1€. Votre impact en faveur d’une presse libre n’en sera que plus fort. Merci.