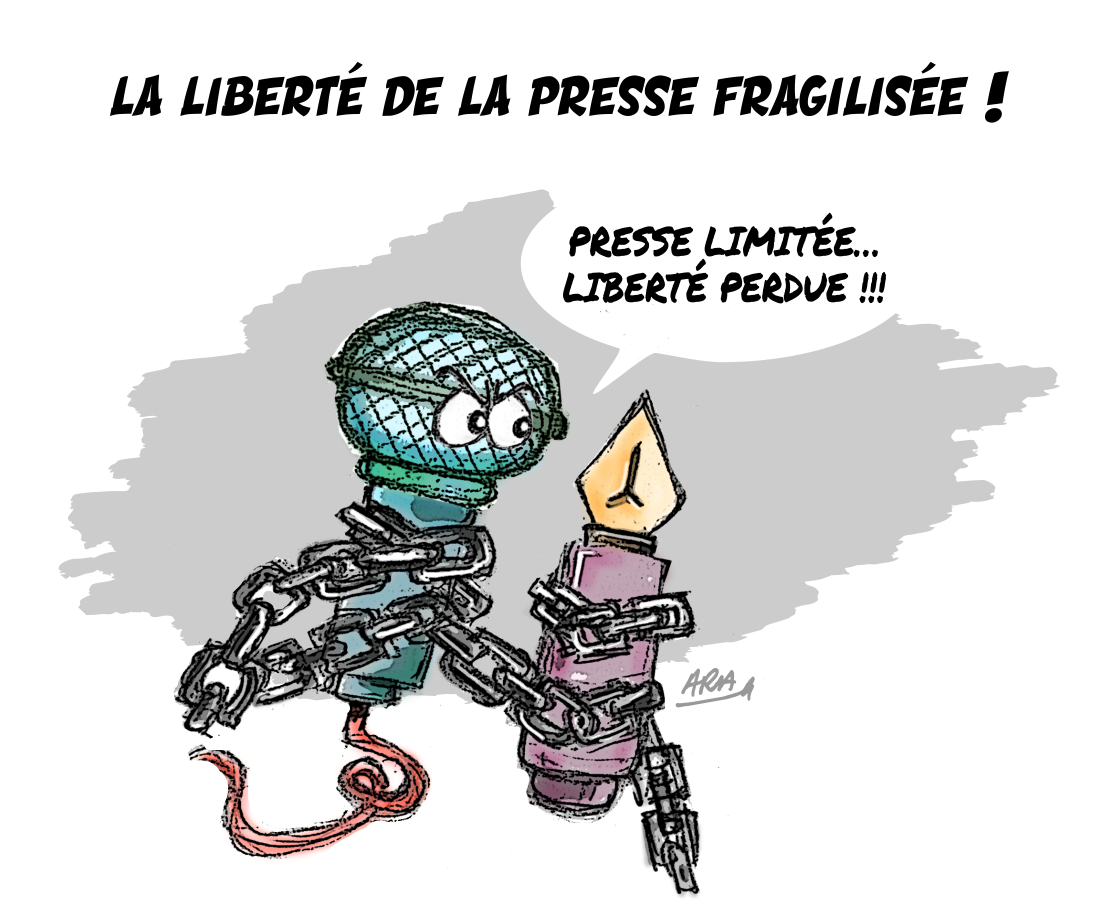Retour sur les bombardements atomiques au Japon (2/4) : Nagasaki, suite

- Retrouvez ici la première partie de cette tribune.
Panorama de Nagasaki
Le musée de la Paix
Arrivé près du musée, je constatais la convergence de groupes d'écoliers et de lycéens se dirigeant tous vers le site. Mais j'eus la chance de pouvoir pénétrer dans l'édifice sans attendre, avant que le gros des élèves n'arrivent. Quasiment tout dans le musée est écrit à la fois en japonais et en anglais.
Dès la première salle, sur des écrans vidéos éparpillés en divers endroits, on peut voir un petit clip d'environ cinq minutes qui regroupe des images terribles de victimes plus ou moins carbonisées, de tous âges, entrecoupées de déclarations choquantes de quelques survivants. On est ainsi brutalement immergés dans l'horreur de la bombe. Je suis resté figé devant un des écrans, abasourdi par des images comme je n'en avais jamais vues. Face à des visions de cadavres de femmes et d'enfants, face aux regards de quelques survivants encore sous le choc au milieu des corps sans vie à leurs pieds, une envie de pleurer me saisit. Après ce premier choc, faisant effort pour garder le contrôle de moi-même, je me décidais à explorer les autres salles.
Le musée suit alors les évènements de manière chronologique. Une première salle est consacrée aux origines de la bombe. Je fus rapidement rattrapé par plusieurs groupes d'élèves de tous âges. À la sortie, ils étaient bien des centaines.
Concernant les origines de la guerre, elle commence pour les Japonais avec ce qu'ils appellent l'incident de Mandchourie, en 1931, qui a ensuite dégénéré en guerre ouverte avec la Chine à partir de 1937. L'entrée du Japon dans la guerre mondiale indo-pacifique semble présentée comme faisant partie d'un tout, comme la continuation logique du conflit avec la Chine. Dans cette présentation relativement neutre, le Japon ne s'accuse pas de l'origine de la guerre, mais ne s'en exonère pas non plus. Le sujet de la responsabilité semble évacué. Cela ne semble pas être la raison d'être du musée.
Quant à la bombe atomique elle-même, on apprend ainsi, d'après le musée, que la décision de bombarder le Japon avec a été prise conjointement par le Président américain Eisenhower et le premier ministre britannique Winston Churchill, au cours d'une réunion à Hyde Park, le 18 septembre 1944 (cela est documenté plus en détail à Hiroshima). Le 31 mai 1945, le “comité intérimaire”, en charge des questions concernant les bombes atomiques, décida que ces dernières devraient être lâchées sur le Japon sans avertissement.
Le 16 juillet, la bombe atomique était testée pour la première fois dans le désert du Nouveau Mexique. Dès le lendemain, 69 scientifiques écrivaient une lettre au Président Truman pour protester contre l'utilisation de la bombe contre le Japon sans avertissement et soulignaient la responsabilité morale qu'implique l'utilisation d'armes de destruction massive. Le 18 juillet, le Japon, ignorant ce qui se préparait contre lui, soumettait une requête à Staline lui demandant d'arbitrer des négociations de paix avec les États-Unis. Le 25 juillet, le président Truman approuvait officiellement la décision de lâcher la première bombe atomique sur le Japon. Le lendemain, la Déclaration de Postdam était publiée. Elle était un ultimatum adressé au Japon exigeant une reddition inconditionnelle. Tout en étant vague sur certains points, elle pouvait être interprétée comme une possible demande de la fin de l'existence même de l'Empereur, ce qui était inacceptable pour les Japonais.
Après cette brève contextualisation historique, on passe ensuite plus en détail aux conséquences de l'explosion de la bombe, d'abord l'onde de choc, qui a tout dévasté dans un rayon d'un kilomètre, et qui a causé des dégâts jusqu'à 4 kilomètres. Ensuite viennent la vague de chaleur, et enfin les radiations. Dans le musée, il y a une salle dédiée à chaque type de conséquence. C'est alors que je découvris ces premières images terribles des brûlures particulières provoquées par une explosion atomique. D'après certains survivants, c'était comme si un mini-soleil avait vu le jour, l'espace d'un instant, à l'endroit même de l'explosion. La vague de chaleur qui a frappé le sol était estimée entre 3000 et 4000 degrés.
À cette température, quasiment tout ce qui est frappé fond littéralement, y compris les corps. Quelques photos de survivants qui ont eu le côté du corps exposé à la vague de chaleur sont exposées. Je n’avais jamais rien vu de tel. La chair semblait avoir fondu après être entrée en ébullition, en combustion intense, sur un centimètre d’épaisseur. Au niveau du crâne, on atteignait l’os. Comment imaginer que des gens puissent survivre à cela ? Et pourtant, certains ont dû vivre avec ces stigmates. C’était absolument terrifiant. Des victimes d'incendie classiques ne sont généralement pas marquées ainsi, de ce que j'ai pu en voir. Je découvrais qu’il semble y avoir une spécificité à ces brûlures liées à une explosion nucléaire. Cela est quelque chose de particulièrement abominable. Face à de telles images, on se dit alors qu’aucun être humain sensé ne pourrait souhaiter infliger un tel supplice à un autre être humain, encore moins à des civils innocents, encore moins à des enfants.
Le musée d’Hiroshima étant plus grand et plus détaillé sur les mêmes thèmes développés à Nagasaki, je réserve mes autres remarques pour l’article dédié à Hiroshima (la prochaine partie de cette tribune, ndlr).
L'absence de nécessité
Vers la sortie du musée, on peut voir plusieurs citations de personnalités américaines, dont le général Eisenhower, remettant en cause la nécessité de lâcher ces bombes abominables sur le Japon. En découvrant ces mots de contemporains bien informés des évènements, on peut alors acquérir la conviction que ces horreurs étaient non seulement pas indispensables, mais que cela était déjà clair pour un certain nombre d'acteurs de l'époque. Cette impression fut confirmée par une citation d'un rapport américain, publié en 1946, sur l'évaluation des bombardements stratégiques des États-Unis dans la guerre du Pacifique:
"... Certainement avant le 31 décembre 1945, et selon toute probabilité avant le 1er novembre 1945, le Japon se serait rendu même si les bombes atomiques n'avaient pas été larguées, même si la Russie n'était pas entrée en guerre et même si aucune invasion n'avait été planifiée ou envisagée."
“...Certainly prior to Dec 31 1945, and in all probability prior to November 1, 1945, Japan would have surrendered even if the atomic bombs had not been dropped, even if Russia had not entered the war and even if no invasion had been planned or contemplated”.
Face à la cinquième citation sur ce même thème, je m'aperçus que je n'arrivais plus à lire. Les larmes emplissaient mes yeux. On a donc sciemment décidé d'imposer un martyre terrible à des centaines de milliers d'innocents, sachant que cela n'était pas nécessaire pour mettre fin à la guerre. Cette prise de conscience, née de ces citations successives, m'a bouleversé. Juste après avoir vu les images de l’horreur, on ne peut rester de marbre. Je ressentais alors une colère intérieure contre ceux qui ont cyniquement décidé de cela.
Émotionnellement, je comprenais enfin le sentiment de révolte de ce Japonais qui fut mon collègue dans les Balkans. Avant de visiter le musée, je m'étais dit que j'aurais aimé interviewer quelques-uns de ses compatriotes parlant anglais, si cela était possible, pour avoir leurs impressions sur ce musée, sur les évènements auxquels ils étaient consacrés. Mais à ce moment-là, envahi moi-même par l'émotion, je me sentais incapable de parler à qui que ce soit. Il m'a fallu bien 20 minutes avant de recouvrer mes moyens.
Au passage, on pourra remarquer l'habileté des Japonais à convaincre le visiteur de la non-nécessité de ces massacres rien qu'en citant un certain nombre de personnalités issues du pays même qui a décidé de lâcher ces bombes.
Quel est le sentiment des Japonais sur ces évènements ?
Je regardais du coin de l'œil tous ces écoliers Japonais qui m'entouraient et quelques adultes. Je n'arrivais à déceler aucun signe d'émotion. La plupart gardaient le silence. Les plus jeunes écoliers s'affairaient à répondre à des questions sur des cahiers.
Vers la sortie, je découvris alors une équipe de télévision japonaise qui venait couvrir la remise d'un don de l'équipe de football locale au musée. La journaliste correspondante de la chaîne dans la ville et qui parlait un excellent anglais, eut l'amabilité de me consacrer quelques minutes. Selon elle, c'était surtout les écoles de l'île de Kyushu, l'une des 4 grandes îles japonaises sur laquelle est située Nagasaki, qui venaient visiter le musée de la Paix de la ville. “Les bons professeurs emmènent leurs élèves ici, ou à Hiroshima”, dit-elle, doutant que cela soit aujourd'hui systématique dans les écoles.
Selon elle, les enfants d'aujourd'hui se sentiraient plus éloignés de ces enjeux du passé. À la question de savoir si les Japonais pouvaient ressentir du ressentiment vis-à-vis du pays qui les a ainsi bombardés, à l'image de cet ancien collègue japonais cité plus haut, elle répondit : “Nous savons que c'est le Japon qui a commencé la guerre”, ce qui soulignait l'ambivalence de la question, et qui explique que c'est le sentiment de pacifisme qui semble dominer dans la société japonaise et non le ressentiment. Cela est perceptible dans la plupart des écrits que l'on peut voir sur la question. Mais on reviendra sur cette question de la responsabilité dans la troisième partie de cet article.
Les deux jeunes filles en kimono
À la sortie du musée, je remarquais une statue un peu isolée que je n'avais pas aperçue auparavant.
L'œuvre était entourée de deux panneaux explicatifs. Je reconnus sur l'un d'eux la reproduction d'un tableau aperçu dans le musée, mais aussi ailleurs dans la ville. La peinture représentait deux jeunes japonaises gisant en kimono traditionnel sur un autel de crémation, entourées d'une poignée de personnes visiblement en émoi. Voici le tableau et les mots poignants de son auteur:
Les deux jeunes filles d'une dizaine d'années, qui semblaient être deux sœurs, avaient ainsi succombé. Et leurs familles, 10 jours après la bombe, avaient décidé de leur offrir un dernier hommage en les habillant de kimonos traditionnels pour la cérémonie de leur crémation. Il a fallu à l'auteur du tableau 29 années pour immortaliser cette scène bouleversante dont il avait été témoin, une scène où la culture et l'identité japonaise trouvaient encore la force de s'affirmer si dignement face au massacre aveugle de l'innocence et de la beauté. Encore aujourd'hui, je ne peux m'empêcher d'avoir les larmes aux yeux à l'évocation de cette scène tragique.
Un autre panneau à droite de la sculpture nous apprend que cette dernière s'intitule “Enfants ayant confiance dans le futur” et qu'elle a été commandée par la mère d'une des deux jeunes filles décédées, qui souhaitait donner ainsi un sens positif à cette tragédie à la fois personnelle et collective.
La sculpture elle-même représente les deux jeunes filles en kimono en train de s'envoler, légères comme l'air, dans leur voyage vers le monde spirituel, échappant à la lourdeur épaisse des malheurs de l'incarnation sur Terre. Cette image symbolisant la volonté de voir au-delà de la tragédie est assez bouleversante, mais est aussi révélatrice de la spiritualité de la culture japonaise.
La plupart des Japonais avec qui j'ai abordé la question croient en la survie de l'âme après la mort, selon l'enseignement shintoïste, mais aussi en la réincarnation (influence du Bouddhisme). Pour eux, ce sont des faits acquis. Ces croyances essentiellement issues du shintoïsme sur la nature spirituelle des choses sont palpables par exemple dans la plupart des films d'animation du studio Ghibli. Dans le monde, le matérialisme qui nie la nature spirituelle du vivant est propre à l'Occidentalisme dit rationaliste. Ce mouvement de pensée a décidé que tout ce qui n'était pas démontrable grâce à la science, qui est elle-même pourtant limitée, n'existait pas. Les démons de la guerre se sont un temps emparés du Japon, mais la spiritualité n'a pas disparu pour autant.
Au pied de la statue, on pouvait voir quatre sortes de petites cocottes en papier. On en trouvait beaucoup dans le musée, notamment le long du mur de la longue allée circulaire qui descend vers l'entrée. Une longue guirlande constituée de 1000 oiseaux en papier y accompagne les visiteurs. Ici ou là, dans les jardins, on retrouve ces figurines liées entre elles sous forme de guirlandes ou de bouquets. Alors que je m'interrogeais sur leur signification, je m'aperçus que deux jeunes femmes d'une vingtaine d'années m'avaient rejoint près de la statue. Elles étaient bien entendu masquées (le Japon n’a généralement pas réussi à se défaire du port du masque, devenue une nouvelle normalité depuis 2020). À tout hasard et sans trop y croire, je leur demandais si elles parlaient anglais. À ma grande surprise, l'une des jeunes femmes me répondit dans un anglais impeccable, ce qui est rare au Japon. La charmante Miki me rappela que l'on appelait ces figurines de papier des origamis, et qu'elles représentaient des grues, oiseau symbole de chance au Japon. Elle expliqua qu'il était de tradition d'offrir ces origamis pour honorer les défunts, comme pour porter bonheur à leurs âmes.
Tout fit alors sens. Wikipédia confirme que ces oiseaux sont pour les Japonais symboles de “chance, de longévité et de fidélité”. La mère d'une des jeunes filles tentait de noyer son chagrin en pliant ces grues en papier avant d'avoir l'idée lumineuse de demander un monument d'espoir à la mémoire de sa fille et de son amie d'infortune.
Miki m'expliqua qu'elle venait de loin, de la région du mont Fuji, près de Tokyo, pour visiter Nagasaki.
Je lui fis alors remarquer que le panneau explicatif sur la droite de la statue était abîmé, comme si quelqu'un avait tenté de brûler le film de plastique qui le recouvrait, et que c'était le seul panneau commémoratif du parc dans cet état. Pensant à la guerre en Ukraine, qui en fait oppose l'OTAN et la Russie, j'espérais que cela ne soit pas un sombre présage sur la paix du monde. Je partageais cette interrogation avec mon interlocutrice du moment, aussi pour sonder un peu comment on perçoit le conflit russo-ukrainien au Japon. Mais il n'y eut pas de réponse sur la question.
Au final, Miki me demanda où elle pourrait lire l'article, et puis elle et son amie se sont ensuite comme envolées, courant littéralement vers le musée, craignant peut-être qu'il ne ferme.
Ce faisant, elles me laissaient face à mes questions existentielles sur l'avenir du monde, un monde, notamment occidental, qui semble si loin d'être dirigé par des sages, des sages qui seraient légitimement émus face aux malheurs de Nagasaki et qui devraient alors penser “plus jamais ça” et qui agiraient en conséquence, non-pas en nourrissant la guerre, la propagande et la haine, mais en poussant à de vraies solutions diplomatiques. Mais ce que la guerre russo-ukrainienne a démontré, c'est que l'Europe de la Paix qu'on nous avait vendue n'existe plus. Il faudra la réinventer, un jour.
Nb : toutes les photos publiées ici ont été prises sur place par Jean Neige. Aucune de ces photos n’a été prise dans le musée.
À LIRE AUSSI
L'article vous a plu ? Il a mobilisé notre rédaction qui ne vit que de vos dons.
L'information a un coût, d'autant plus que la concurrence des rédactions subventionnées impose un surcroît de rigueur et de professionnalisme.
Avec votre soutien, France-Soir continuera à proposer ses articles gratuitement car nous pensons que tout le monde doit avoir accès à une information libre et indépendante pour se forger sa propre opinion.
Vous êtes la condition sine qua non à notre existence, soutenez-nous pour que France-Soir demeure le média français qui fait s’exprimer les plus légitimes.
Si vous le pouvez, soutenez-nous mensuellement, à partir de seulement 1€. Votre impact en faveur d’une presse libre n’en sera que plus fort. Merci.